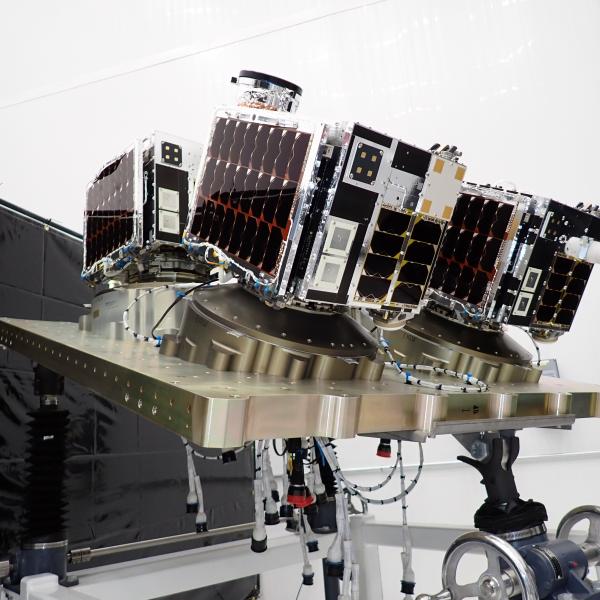En raison de la fonte des glaces de mer qui facilite l’accès des navires aux eaux arctiques et de l’intérêt géopolitique croissant pour cette région, la défense de la frontière nordique du Canada figure désormais parmi les grandes priorités stratégiques du gouvernement fédéral.
Cependant, assurer des patrouilles dans une zone aussi vaste et éloignée s’avère une tâche ardue, d’où le rôle important que pourraient jouer les véhicules aériens sans pilote dans la préservation de la souveraineté de l’Arctique. En fournissant en temps utile des renseignements précis sur les mouvements des navires et des aéronefs, ils pourraient combler des lacunes de longue date en matière de surveillance dans l’ensemble de la région.
Aujourd’hui, Melissa Greeff, chercheuse en génie robotique, conçoit une nouvelle génération de drones autonomes capables de naviguer dans ce type d’environnement hostile et éloigné.
Des drones de surveillance chargés à bloc
Au laboratoire Robora (en anglais seulement), situé à l’Institut de recherche Ingenuity Labs (en anglais seulement) à l’Université Queen’s (en anglais seulement), à Kingston, en Ontario, Melissa Greeff supervise une douzaine d’étudiantes et d’étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs qui travaillent sur des ordinateurs portables en vue de roder des logiciels ou de mettre au point le dernier prototype. D’autres effectuent des essais dans des conditions réelles dans le ciel de Kingston.

« Notre objectif est de repousser les limites le plus loin possible », explique-t-elle.
La durée de vie limitée des batteries utilisées par les drones constitue l’une des principales contraintes auxquelles l’équipe se heurte, en particulier dans les régions éloignées où l’infrastructure de recharge se fait rare. Melissa Greeff et son équipe mettent donc au point des systèmes permettant de faire atterrir les drones en toute sécurité sur des bornes de recharge robotisées situées en mer, plutôt que de les rappeler constamment à la base.
Les drones sont dotés de capteurs intégrés extrêmement légers en vue de réduire la charge utile. Et pour permettre au drone de naviguer de manière autonome, l’équipe développe des algorithmes de commande aussi efficaces que possible sur le plan des calculs, afin que l’ordinateur de bord consomme un minimum d’énergie.
Il est essentiel d’améliorer les algorithmes de commande afin que les drones puissent résister aux vents violents et aux conditions difficiles qui règnent dans l’Arctique. Il ne s’agit pas seulement d’améliorer la réaction des drones à leur environnement, mais aussi de prévoir ce qui se prépare. « Nous devons prendre les données que nous recueillons en vol et les mettre à profit », explique la chercheuse.
Alors que la plupart des recherches dans ce domaine s’appuient sur des simulations, l’équipe du laboratoire Robora soumet les drones à des essais en conditions réelles afin de s’assurer qu’ils sont capables de s’adapter à des environnements hostiles.
« Il y a une grande différence entre les conditions de simulation et celles de l’Arctique, explique Melissa Greeff. Pour combler cet écart, il faut notamment tester dans des conditions réelles les algorithmes que nous développons. »
La chercheuse affirme qu’elle n’aurait sans doute pas pu réaliser ses travaux sans le soutien de la FCI, qui a financé les bornes robotisées de pointe, le système de stockage des données et les capteurs. « Il aurait été impossible de mener à bien ces recherches sans cet équipement », affirme-t-elle.
Le ciel, espace de tous les possibles
Les drones jouent un rôle de plus en plus important dans les domaines du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance dans le monde entier. D’ici 2032, on s’attend (en anglais seulement) à ce que le marché des drones militaires soit multiplié par près de trois, passant de 16 à 47 milliards de dollars américains, en grande partie grâce à ces applications.
Ces mêmes aéronefs sans pilote peuvent également être utilisés pour les opérations de recherches et sauvetage, les secours en cas de catastrophe et l’acheminement de fournitures médicales vitales dans les zones de guerre.
En faisant en sorte que les drones soient suffisamment résistants et adaptables pour faire face à l’environnement impitoyable de l’Arctique canadien, les travaux de recherche de Melissa Greeff permettront à la prochaine génération de drones de mener à bien les missions les plus difficiles.
Le projet de recherche présenté dans cet article est également financé par Mitacs et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.